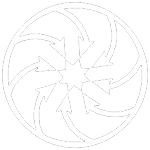La première fois que je mis les pieds en Union Soviétique, le pays s’enveloppait encore d’une aura de mystère et de crainte sourde — une forteresse idéologique aux murailles opaques, figée dans un autre temps. Peu de gens, en France, connaissaient des Russes. Seuls quelques exilés de la révolution, vieux et discrets, fréquentaient la cantine du conservatoire Sergueï Rachmaninov, sur les quais tranquilles du Trocadéro.
À cette époque, j’étais journaliste pour la rédaction des journaux et magazines de la Une, la première chaîne publique. Il m’arrivait de collaborer aussi à des projets destinés aux États-Unis, produits par Edward Flaherty, un Californien expatrié que j’avais rencontré lors de mon retour de Los Angeles, après notre passage commun sur le show américain You Ask For It.
Edward me proposa un sujet singulier : suivre la création d’une comédie musicale intitulée Les Enfants de la Paix, réunissant sur scène des enfants russes et américains. Le projet, impulsé par un producteur britannique, s’inscrivait dans l’élan de détente promu par le nouveau maître du Kremlin, Mikhaïl Gorbatchev. Notre équipe était hétéroclite : Edward, qui comptait vendre le reportage à ABC, Christian Jack, caméraman pour CBS, et un homme massif, un peu fatigué, envoyé par le Wall Street Journal.
Obtenir un visa de tournage n’avait rien d’une formalité. L’URSS n’accordait qu’un seul visa presse par pays, assorti d’une obligation de résidence à Moscou. En jouant mon va-tout, je me présentai sans prévenir chez le secrétaire général de la Une. Il me signa une lettre de mission, sans engagement financier. C’était peu, mais suffisant pour embarquer dans cette aventure.
À Moscou, nous fûmes logés dans un hôtel géant, tout juste construit pour accueillir les étrangers. Un monde à part, sans lien avec la réalité quotidienne des Russes. Sur la place Rouge, des gamins silencieux proposaient des poignées de roubles pour un seul dollar, alors que le taux officiel fixait le change à deux dollars pour un rouble. La pérestroïka venait à peine de naître. Les étrangers étaient des créatures exotiques, observées avec une curiosité mêlée de méfiance.
Un soir, nous fûmes invités à boire un verre chez un architecte américain. Voilà dix ans qu’il vivait là, à bâtir la future ambassade des États-Unis. Ami de Reagan, il portait un regard tendre sur les Russes, loin de la paranoïa alimentée par les médias occidentaux. « Si les Russes envahissaient New York, plaisanta-t-il, on leur volerait leurs bottes le premier jour. » Il évoquait une société sous contrôle, certes, mais étrangement sûre — où une femme seule pouvait traverser Moscou à pied, en pleine nuit, sans crainte.
La troupe de la comédie comptait une soixantaine d’enfants — chanteurs, danseurs, comédiens, âgés de six à quatorze ans, Russes et Américains mêlés. L’orchestre était dirigé par Stas Namin, petit-fils d’Anastase Mikoyan, un proche de Staline. Sa compagne, chanteuse, venait de la famille d’Andropov. Aucun des deux n’était véritablement talentueux, mais leur notoriété leur tenait lieu de légitimité. Nous avions là des enfants du système — et cela nous rendait, sinon intouchables, du moins protégés.
Un jour, Stas nous emmena à la campagne. Contrôlés à la sortie de la ville, il fallut un échange rugueux avec la police pour obtenir le passage. Les datchas de la nomenklatura, vantées comme des palaces soviétiques, n’étaient que de modestes pavillons, à peine au niveau d’une résidence secondaire française.
Un soir, nous visitâmes un vieil acteur célèbre, ancien interprète de Staline au cinéma. On racontait que son appartement, face à la Loubianka, était tapissé d’or. Il n’en était rien : les meubles étaient fatigués, les murs inégalement peints, et une tristesse poisseuse s’accrochait aux rideaux fanés. Le vernis du rêve socialiste s’écaillait lentement.
La tournée nous mena dans plusieurs villes, dont certaines étaient interdites aux médias étrangers. À Oulianovsk, ville natale de Lénine, nous filmâmes sa maison — modeste, propre, figée comme un musée. Quand je demandai pourquoi toutes les maisons n’étaient pas aussi bien entretenues, Christian me fit signe de me taire. Le silence, ici, tenait lieu de diplomatie.
Nous devions rejoindre Kiev quand survint la catastrophe de Tchernobyl. L’annonce fut floue. Les enfants reçurent pour seule consigne de ne plus manger de glaces à la crème : les pâturages seraient, disait-on, contaminés. Nous prîmes la route vers la Crimée. Après un long trajet cahotant, nous atteignîmes Yalta, visitâmes le palais d’été des tsars et les lieux du traité.
Et là, surprise : c’était la grande fête annuelle des pionniers soviétiques, équivalents de nos scouts. Des milliers d’enfants, en uniforme impeccable, défilaient dans un ordre parfait. C’était un carnaval discipliné, fascinant dans sa mécanique collective.
Durant tout le voyage, nous étions suivis — officiellement par nos traducteurs, officieusement par de mystérieux accompagnateurs aux visages fermés. Ils nous rappelaient sans cesse ce qu’il ne fallait pas filmer : ponts, aéroports, gares — toutes cibles dites « stratégiques ». Christian, espiègle, filmait en douce tout ce qui était défendu.
De retour à Moscou, nous visitâmes le bureau local de CBS. La correspondante nous accueillit avec un large sourire. Quand nous mentionnâmes nos images de ponts interdits, elle nous montra un mur de cassettes : tout le monde filmait ce qu’il ne fallait pas filmer. L’interdit avait quelque chose de folklorique.
Le jour du départ, le vent fouettait la neige sur le tarmac. À l’aéroport, nos discrets accompagnateurs arboraient des passeports différents de ceux des citoyens ordinaires. Dans le hall, six officiers du KGB, en uniforme impeccable, bottes brillantes, entouraient un représentant d’Ostankino, la télévision soviétique. L’homme réclamait cinquante mille dollars pour l’exportation de nos cassettes.
Les enfants et leurs accompagnateurs étaient déjà à bord. L’équipe technique fumait des Marlboro avec les officiers, étonnamment courtois. Edward, imperturbable, entama une longue négociation. Une heure plus tard, il consentit à signer un chèque sans provision de vingt mille dollars. Ce fut notre ticket de sortie.
Ainsi s’achevait notre périple en URSS. Un monde suspendu, qui vacillait lentement sur ses bases, cherchant encore comment s’ouvrir sans se perdre