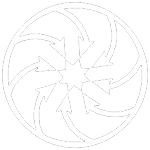Nous vivions au Salvador comme on séjourne dans l’antichambre d’un cataclysme, entre deux secousses telluriques, sur une Terre incertaine, encore mal arrimée à sa propre réalité. Ce n’était point tout à fait le globe tel que le décrivent les traités de géographie, mais une version instable, fissurée, penchée sur l’abîme d’une faille invisible. Le ciel y prenait parfois des teintes maladives, semblables à une blessure lumineuse, et l’Océan Pacifique, vaste confesseur, murmurait ses secrets dans le roulement obstiné de ses vagues. Le sommeil y était rare. L’attente, permanente. Nous guettions quelque chose — une commotion, une vérité, peut-être l’ouverture d’un vortex ignoré des savants.
Bruno — que l’on nommait tour à tour Big Kev, Orso Blanco ou Bruno Flake, selon l’humeur et le degré de familiarité — habitait une modeste construction de béton, lézardée de toutes parts, dressée face à l’immensité marine comme une prière silencieuse adressée aux forces élémentaires. Les murs y exsudaient une humidité persistante, et les moustiques s’y accrochaient avec l’obstination des souvenirs que l’on ne parvient pas à chasser. Bruno attendait les grandes houles du mois d’août avec la ferveur d’un pèlerin espérant une apparition. Elles venaient toujours. Infailliblement. Et avec elles paraissaient Ocean Breeze et Cosmos, deux insulaires d’Hawaï, hommes étranges aux regards embrumés, imprégnés d’oubli et de fumées verdâtres. Ils ne sortaient de leur réserve que lorsque la mer dépassait les quatre mètres, lorsque la vague cessait d’être un phénomène pour devenir une entité quasi divine.
Je ne suis, pour ma part, qu’un surfeur médiocre. Toutefois, en ces eaux tièdes saturées de clarté, parcourues d’ondes longues et régulières, il me sembla entrevoir une forme d’absolution. Kevin m’avait confié une antique longboard australienne, une Hobby vénérable, qui avait jadis fendu les vagues de Jeffrey’s Bay durant ce que les anciens appellent l’âge d’or. Cette planche possédait une mémoire. Moi, j’avais perdu la mienne. Il ne me restait que cette matinée.
Nous gagnâmes le large à l’aube. Le monde paraissait lavé de toute souillure nocturne. Le ciel se déployait en couches laiteuses, superposées comme les strates d’un globe céleste en formation. Le temps n’avait pas encore commencé — seule régnait l’attente.
Nous ramions. Le clapotis régulier des planches, la respiration mesurée des hommes. On eût dit une Atlantide sous l’effet d’un acide lumineux. Un premier train de houle s’annonça : des collines d’eau s’élevant avec lenteur, comme si l’océan se souvenait soudain de lois anciennes. Trois vagues. Toujours trois. Et toujours la troisième, la plus limpide, la plus décisive.
J’hésitai. Je demeurai au sommet. Sous moi, la masse liquide se transforma. Une arche suspendue dans le vide — cinq mètres de hauteur, quarante d’épaisseur — une véritable cathédrale d’eau en équilibre précaire. Puis elle s’abattit.J’aperçus Bruno s’éloigner, son dos brillant, bientôt englouti par une brume irisée.Je redescendis, choisis une vague plus clémente, et pris le chemin du retour.
La glisse était pure, frontale. L’eau aspirait la planche avec une force méthodique. Je distinguais le fond marin avec une netteté troublante : un ballet de jeunes requins évoluait dans le vert translucide. Le ressac hurlait à deux mètres — trop violent pour les planches de mousse, suffisant pour les réduire en fragments. Le vent soulevait les masses d’eau comme des tentures, les suspendait dans l’air. Vingt pieds de vide. Un mur haut de trois étages.
Cosmos et Ocean Breeze surgirent d’un tube, silhouettes incertaines, presque spectrales. Ils s’effacèrent bientôt dans l’écume, très loin, comme s’ils se dissolvaient dans la substance même de l’océan, retournant à leur élément originel.
Les vagues ne sont point du simple mouvement. Ce sont des révélations. On ne les chevauche pas : on les épouse. Chaque courbe est une langue oubliée, chaque chute une offrande consentie. Les surfeurs — les véritables, non ces histrions sponsorisés — déchiffrent des textes secrets. Le Livre d’Urantia, d’obscures fictions raciales mal imprimées, des mythes antiques mêlés à des reproductions imparfaites de bandes dessinées tombées dans l’oubli. Ils évoquent les rois d’Honolulu, les duels sur des troncs de balsa. Non point celui qui va le plus loin, mais celui qui demeure le plus longtemps dans l’eau. Dedans. Immergé. En état de transe.
La terre, ici, semblait pacifiée. Mais dans l’eau — c’était la guerre. Une joute de mousse et de chair, une chevalerie en boxer short, où l’on s’éclaboussait comme on croise le fer, sous l’œil indifférent et éternel de l’Océan.