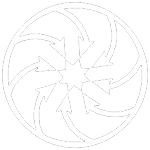Paris avait ce goût d’éternité insouciante que seules les villes blessées savent offrir lorsqu’elles se relèvent. C’était une fête, comme l’avait écrit Hemingway, mais une fête à la française : plus désinvolte, plus enfumée, plus sensuelle. Des essaims de jeunes gens en quête d’absolu, ex-minets désœuvrés du Drugstore devenu temple profane, flottaient en jeans pattes d’eph’ et colliers de perles autour des brumes vertes du cannabis. Le monde leur semblait enfin à portée de main – ou du moins à portée de joint.
J’étais alors étudiant en histoire à la Sorbonne, Paris IV. J’habitais chez Lucia Lyon, ma petite amie, au 36 rue de Passy – un appartement haussmannien baigné de cette lumière tiède et dorée qui n’appartient qu’à l’Ouest parisien. Lucia partageait le loyer avec deux Péruviennes exubérantes et rêveuses. Elle-même venait du Yorkshire, d’une de ces familles anglaises dont les manoirs sentent le cuir ciré et le thé noir, avec pour ancêtres des recteurs, des officiers de marine et des magistrats de comté. Avant de venir à Paris, elle avait été jeune fille au pair chez les de Vergie, une famille dont le nom portait encore l’écho des ducs de Bourgogne.
Mais leur splendeur avait passé. Le château de Touffou, jadis fleuron de l’Anjou, autrefois peuplé de piqueux, de maîtres-chiens et de lingères, n’était plus qu’un souvenir inscrit en lettres d’or sur des registres d’héritage. Olida, leur entreprise familiale, avait périclité. La jeune madame de Vergie s’était donné la mort ; Enguerand, le patriarche, ruiné par la confiance placée dans un escroc, dut vendre le château. Ce fut David Ogilvy, le pape de la publicité, qui l’acheta. Enguerand, comme un roi déchu, se replia dans un relais de chasse, avec pour seule compagnie Emile, son chauffeur – ombre fidèle d’un passé disparu.
Edouard, l’aîné, beau garçon au port altier, fréquentait Nanni de Rothschild. Il semblait promis à une belle vie dans les salons feutrés de la tradition. Mais à la mort de sa mère, il s’évanouit. Il partit en Inde, sans retour. Un voyage mystique, disait-on. Le cadet, Fabrice, n’avait que seize ans. Il s’émancipa à marche forcée, s’engageant dans la Marine nationale. Tous deux haïssaient leur père pour avoir brisé leur mère en aimant la gouvernante – une trahison aux allures de tragédie antique.
Fabrice fréquentait une certaine aristocratie de la particule : parmi ses amis figurait Inès de Bourbon-Parme, grande fille brune à la beauté vive, rieuse et impatiente, avide d’un autre monde que celui des messes et des dîners compassés. Elle rêvait, comme nous tous, d’îles perdues dans les mers du Sud, de nuits chaudes et de ciels en fleurs. Nous écoutions My Sweet Lord en tirant sur des joints de Maazar-i-Sharif, et tout nous semblait possible.
L’année universitaire s’achevait, mes parents n’avaient prévu pour l’été que leur éternel pèlerinage en Gascogne, chez ma grand-mère. J’avais dit que je cherchais du travail. Un matin, Inès me souffla que sa mère cherchait quelqu’un de confiance pour s’occuper de sa bibliothèque. Le lendemain, elle me réveilla vers dix heures – une heure criminelle, selon mes standards – pour me dire que la princesse m’attendait. L’entrevue fut donc reportée à l’après-midi.
Je me rendis rue de Franqueville, dans un de ces immeubles haussmanniens aussi solennels qu’un ministère. Une domestique asiatique, fluide comme une ombre, m’introduisit dans un bureau sombre et silencieux. J’y rencontrai Son Altesse la princesse Yolande de Bourbon-Parme, née de Broglie.
Je portais un pantalon en velours vert, mes boucles en bataille, les yeux encore lourds des fumées de la veille. Pourtant, elle ne sembla pas s’en formaliser. Je lui dis que j’étais étudiant en histoire. Cela lui suffit.
— « J’ai besoin de quelqu’un pour inventorier la bibliothèque de Crespières. Il faudra ouvrir chaque volume pour le faire sécher, cirer les reliures au saddle-soap, et noter ceux qui nécessitent une restauration. »
Je planais à moitié, mais j’écoutais. Elle poursuivit :
— « J’ai souvent confié cela à des professionnels. Ils m’ont tous volée. »
Avant même que je ne dise oui, elle me tendit trois cents francs pour acheter le saddle-soap chez Hermès.
Je n’avais même pas demandé combien je serais payé. Peu importait. Plus tard, Inès me souffla que je serais rémunéré comme un bon secrétaire. Cela me convenait. J’étais aux anges. Pour la première fois, j’allais vivre un été d’aventure, d’histoire et de solitude, dans un château.
Le château de Crespières – ancien relais de chasse de Louis XIV, à vingt kilomètres de Versailles – m’attendait. J’y habiterais seul. Les gardiens, un vieux couple au regard paisible, m’apporteraient provisions et bois de chauffage. Je devais, sur ordre exprès de la princesse, maintenir un feu continu dans la grande cheminée du salon. C’était nécessaire, disait-elle, pour chasser l’humidité. Je trouvai dans cette consigne quelque chose de poétique, comme si la mémoire des livres exigeait d’être gardée au chaud.
Le château de Crespières me parut, dès la première vision, magnifique — mais triste, comme un vieux livre oublié sur l’étagère du monde. Fabrice, lui, l’avait qualifié de « hideux », mais nos sensibilités divergeaient comme deux langues mortes que plus rien ne reliait. Le domaine était ceint d’un vieux mur de pierre de deux mètres, surgi d’un autre siècle, et devant le bâtiment principal, un lac rectangulaire dormait. En son centre, une île boisée, muette, semblait attendre depuis toujours. Tout paraissait à l’abandon, et c’est peut-être cela qui me séduisit.
Je me mis au travail dès mon arrivée. La bibliothèque, que j’imaginais monumentale, s’avéra plus modeste, mais cette illusion était due aux vastes proportions des pièces. Le gardien, un vieil homme nommé Ignace, m’accueillit d’un air distrait, le visage creusé par les années et les silences. Il me parla de la guerre, d’une blessure qui l’avait privé d’enfants, et chaque jour, il apportait d’immenses fagots de bois. Sa femme, taiseuse, déposait les plats qu’elle cuisinait sans jamais lever les yeux.
Je passais mes journées à extraire les livres des rayons, les ouvrant pour les ventiler, les dressant sur la tranche autour de la cheminée du grand salon. Il s’agissait presque exclusivement d’ouvrages d’histoire, et je compris vite qu’ils composaient la bibliothèque de Philippe de Fléchie, intendant du Roi Soleil. Beaucoup de ces livres n’avaient pas été ouverts depuis des décennies. J’étais persuadé que la princesse actuelle ignorait jusqu’à leur existence.
Le soir venu, je cessais de cirer les reliures. Les livres secs et intacts retournaient sur leurs étagères. Dans un grand cahier à spirale, je consignais leurs titres et leur état. Puis je descendais dans la cuisine, vaste et brillante comme un restaurant oublié par le monde, y préparais un repas, fumais un joint. Ma chambre se trouvait à l’étage des domestiques, où j’avais découvert une série noire poussiéreuse. Les jours passaient ainsi, rythmés par les pages que je tournais et la solitude immense.
Un week-end, Jean-Marc et sa petite amie Marie-Ange vinrent me rendre visite. Ce fut la seule interruption dans cette lente retraite. Un jour, je découvris dans la bibliothèque un mécanisme ingénieux dissimulé derrière une étagère. Il libérait un escalier en colimaçon menant à une cave voûtée, emplie de rouleaux, de cartes, et de manuscrits de généalogie. Mon cœur s’emballa : j’avais cru découvrir un passage secret, un trésor oublié. Mais ce n’était qu’un écho du passé. Ignace me parla d’un tunnel muré reliant Crespières au château Rothschild, à huit kilomètres de là. Une voie de fuite huguenote, m’assura-t-il, construite au Moyen Âge.
Une nuit, alors que je lisais un James Hadley Chase, une petite faim me poussa vers la cuisine. Les oies de Marcel criaient sous la lune pleine, et je traversai la maison, une tasse de chocolat à la main, pour jeter un dernier coup d’œil à la bibliothèque. Là, sur une étagère que je pensais avoir vidée, un volume attira mon regard. Reliure ancienne, inscription effacée. Sur la tranche, on lisait simplement : « De la Philosophie ». Il était manuscrit, paginé à la main, divisé en trois sections, datées de trois siècles distincts à partir de 1475. Le premier traité détaillait la fabrication de la pierre philosophale, le deuxième une étude démonologique, le troisième, un ensemble d’éphémérides astrologiques.
C’est alors que les choses commencèrent à changer.
Peu avant mon départ, Inès vint passer un week-end. En manipulant la carabine chargée qu’Éric le frère d’Inès, avait laissée, je faillis l’abattre. La balle traversa la hotte en verre des fourneaux. Ignace, impassible, affirma qu’il avait laissé la cartouche à dessein, pour « donner une leçon à ce galopin d’Éric ». Je rentrai chez mes parents à Neuilly avec ce livre sous le bras. Avec Marc Régnier et Jean-Marc Landau, nous tentâmes d’appliquer les recettes alchimiques. Les prières obligatoires nous rebutèrent ; alors nous essayâmes un rituel démonologique pour gagner aux jeux. Ce fut un échec. Les drogues nous entouraient comme un brouillard. La « blanche de Marseille » circulait partout. Landau expérimenta un produit allemand nommé perfectine, qu’il prenait pour de la cocaïne synthétique, mais qui n’était qu’un redoutable psychotrope.
Lucia partit chez ses parents. Je sombrai. Je m’installai dans un vieux bureau avenue de l’Opéra que mon père avait conservé. J’y cachai le livre dans une armoire. La mère de Landau me dit qu’il avait été interné. Moi-même, j’étais au bord du gouffre. Lucia revint. Août approchait, et nous partîmes vers Biarritz dans une coccinelle orange qu’elle avait rapportée d’Angleterre. Le camping était rempli de surfeurs étrangers. Malgré l’air salé et le soleil, les disputes avec Lucia devenaient fréquentes. Je n’allais pas bien. Un soir, nous prîmes en stop deux hippies crasseux. Ils nous hébergèrent dans une ferme et parlèrent de messes noires. Je me demandai si c’était ce livre qui m’attirait ces rencontres troubles.
De retour à Paris, Lucia me quitta pour de bon. J’achetai un billet de charter pour Los Angeles. Il fallait le récupérer à Londres, chez le coureur automobile Sterling Moss, où logeait la fille qui les vendait. Avant mon départ, j’eus une dernière étreinte avec Lucia. Elle me confia qu’elle avait toujours rêvé d’un enfant de moi, mais qu’elle avait désormais peur.
Trois ans plus tard, je revins en bonne santé, la tête pleine d’aventures californiennes. Je passai chez les Rovinski. Olivier buvait. Dominique était devenu un junkie. On sonna. J’ouvris. Un instant, je crus voir une tête de mort. C’était Inès. Amaigrie, méconnaissable. Elle m’annonça qu’elle partait pour Londres, sur la piste du livre. Je ne lui en avais jamais parlé. Marc Régnier, probablement.
Deux jours plus tard, j’appelai Marc. Il me dit qu’il avait tenté de la joindre, mais le père d’Inès, le prince Michel, lui avait annoncé sa mort, le lendemain de son arrivée à Londres. Et qu’il tenait Marc pour responsable.
Avait-elle retrouvé le livre ? Je ne le saurai jamais.
Nous avions tous lu cette phrase, gravée à la plume sur la première page du manuscrit, mais aucun de nous ne l’avait vraiment entendue. C’était une ligne sèche, austère, comme on en lit tant dans les grimoires anciens. Une menace peut-être, ou un simple avertissement pour effrayer les curieux. Elle disait :
« Que celui qui s’engage dans la recherche de la pierre philosophale sache qu’il risque la ruine, la folie ou la mort. »
Et pourtant, nous avons continué. Avec l’innocence des enfants qui jouent au bord du gouffre. Avec la présomption des modernes, qui croient avoir tué les dieux.
La ruine ne fut pas immédiate. Elle vint lentement, comme une marée noire. Elle infiltra nos vies comme une ombre familière. Ce n’est qu’avec le recul que je la vis se déployer, méthodiquement, dans chaque recoin de mon existence.
D’abord, il y eut la solitude. Non pas celle qu’on choisit pour méditer, mais celle qu’on subit, comme une maladie contagieuse. Les amis s’éloignèrent, un à un. Jean-Marc, qui avait trop pris de la Perfect in, c’est amphétamines dévastatrice, se retrouva à l’hôpital psychiatrique. Fabrice qui tatoue pour aller rejoindre son frère en Inde et quand il revint si tu as dans un accident de voiture alors qu’il allait avoir un enfant avec sa nouvelle compagne.
Quant à moi, je commençai à rêver. Pas des rêves normaux, non. Des visions. Des architectures impossibles. Des forêts de symboles. Des yeux qui me regardaient à travers les murs. Je crus d’abord à une plaisanterie, puis à une folie passagère. Mais le malaise persistait. J’en vins à croire que le livre m’avait choisi. Que ce n’était pas un hasard si je l’avais trouvé là, seul, au milieu d’une bibliothèque vide. Et peu à peu, cette idée me rongea. J’avais brisé le sceau. J’avais désobéi.
Je crois que c’est cela, le secret de la pierre philosophale : ce n’est pas une substance, mais une question posée à l’âme. Une épreuve. Un poison lent. Elle ne transforme pas le plomb en or, mais l’homme en ruine.
Et moi, je l’ai appris trop tard.