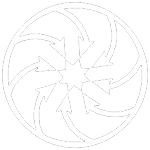GIl est des rencontres que le destin place sur notre chemin sans explication rationnelle, comme si quelque force mystérieuse, tapie dans les replis du quotidien, s’amusait à jeter le pont entre des mondes incompatibles. Ainsi en fut-il de mon amitié avec Gilles Ulrich, dit Gillou, que rien ne prédestinait à croiser la route d’un adolescent de Neuilly, élevé dans la ouate morale et sociale du lycée Janson-de-Sailly.
Gillou appartenait à une lignée tout à fait singulière : celle des camelots des grands boulevards, ces histrions modernes dont la voix couvre le vacarme de la ville pour vanter les mérites de merveilles techniques aussi improbables qu’une éplucheuse de pommes de terre révolutionnaire ou une seringue en plastique pour réaliser une mayonnaise en un temps record. Son père, homme trapu et ventripotent, arborait une barbe épaisse et une gouaille inépuisable. Tel un bateleur de foire médiéval, il captivait les badauds grâce à une éloquence savamment rodée, doublée d’une dextérité manuelle qui confinait à l’illusionnisme.
Leur métier portait un nom officiel : démonstrateur de produits, mais derrière cette appellation bureaucratique se cachait tout un art, une science même, qui n’avait rien à envier à l’alchimie. En pénétrant cet univers par l’intermédiaire de Gillou, je découvris une humanité insoupçonnée, un peuple de gitans sédentarisés, logé dans un modeste appartement de la rue du Petit Musc, au cœur du Marais. Outre ses parents et un jeune couple, la maisonnée comptait un certain Germain, homme taciturne et aux allures de domestique d’autrefois, dont la mission consistait à préparer la magie — notamment en sélectionnant les tubercules aux calibres adéquats pour que la démonstration se déroule sans accroc.
Il me fut ainsi donné d’observer les coulisses du théâtre marchand, d’assister à l’organisation méticuleuse de ce que l’on appelait la postiche, cette mise en scène savamment orchestrée dans laquelle le camelot jouait le rôle principal, tandis que des barons — comparses infiltrés dans la foule — déclenchaient les achats en simulant l’enthousiasme et la spontanéité du client ravi. Un mécanisme psychologique d’une efficacité redoutable, que l’on aurait pu analyser selon les lois de la suggestion et de l’imitation si chères aux psychologues du XIXe siècle.
Gillou, quant à lui, n’était pas seulement un virtuose du trottoir. Ce jeune homme aux cheveux noirs, lustrés et soigneusement peignés, dissimulait sous sa petite stature une énergie contenue, explosive même. Il pratiquait avec sérieux le karaté Shukokai, un art martial japonais transmis à Paris par un certain Maître Cocatre, personnage aussi énigmatique que charismatique. Ancien légionnaire, ce dernier arborait un kimono sombre et une silhouette féline, marquée par une mèche obsédante barrant son front.
Maître Cocatre enseignait un karaté modifié, réinterprété à la lumière de son expérience militaire. Il avait relégué les postures figées du Shotokan au rang d’archaïsmes, préférant une approche plus pragmatique, empruntant à la boxe anglaise la puissance générée par la torsion du buste. Son dojo, vaste salle tapissée d’un tatami de 300 mètres carrés, accueillait une population hétéroclite : durs à cuire, figures interlopes, mais aussi athlètes de haut niveau, tel Valera, colosse au regard calme, que la légende citait comme un champion parmi les champions.
Après les entraînements, il n’était pas rare que nous nous rendions au bistrot voisin, antre enfumé où se produisaient parfois des illusionnistes, dans une atmosphère de cabaret désuet. Là, entre deux verres, les discussions se faisaient plus cyniques : « En cas de bagarre, disait-on, le karaté, c’est bon pour le spectacle. Le mieux, c’est d’attendre que l’autre tourne le dos et de lui casser une bouteille sur le crâne. » Une philosophie qui tranchait singulièrement avec les préceptes de Bushido, mais qui en disait long sur l’environnement dans lequel j’avais mis les pieds.
Pour le jeune homme que j’étais, encore engoncé dans les principes feutrés de la bourgeoisie, cette immersion fut un rite de passage. Le karaté m’a appris la rigueur, le contrôle de soi, et surtout, m’a offert cette assurance intérieure que l’on perçoit, dit-on, chez ceux qui ne reculent plus devant le regard des autres. Même celui des filles.