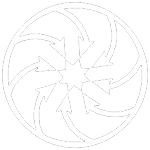Il est des êtres dont l’empreinte, bien que disparus de notre quotidien, persiste en nos pensées comme un phare dans la brume. Ces absents, loin d’avoir été effacés par le temps, demeurent en sentinelles silencieuses, scrutant, semble-t-il, chacune de nos décisions. Tel un regard spectral, leur mémoire continue d’exercer son influence sur notre jugement, nos espérances et parfois même nos regrets. C’est une sorte de petit père, expression affectueuse avec laquelle les paysans de la littérature russe, appeler ceux qu’ils aimait bien.
L’ami dont l’ombre plane encore sur le théâtre de mes souvenirs, fut de ceux-là. C’est à la fin de mon cycle secondaire, dans les austères murs du lycée Janson-de-Sailly, que je le rencontrai. Un garçon à la large silhouette, au port réservé, fils d’une illustre dynastie d’éditeurs — et moi, simple rejeton d’un diplomate reconverti dans l’industri électro-mécanique . Le hasard, aidé d’un petit arrangement ministériel, nous avait placés côte à côte, au cœur d’une classe de Terminale B.
Notre amitié, telle une réaction chimique entre deux éléments inattendus, s’enflamma avec la promptitude des alliances nécessaires. Nous partagions un même statut de « pistonnés », ce qui, dans ce milieu codifié, faisait de nous des anomalies. Mais ces anomalies étaient propices à la complicité. Nous raillions les grands noms du lycée – les héritiers Balkany, les jeunes Bolloré – fiers de leurs voitures anglaises et de leurs vestes taillées chez Renoma, tandis que nous cultivions des goûts plus subversifs : la prose d’Albert Cohen, la gouache appliquée à minuit dans une mansarde de Neuilly, les douceurs interdites du cannabis.
Oui, qu’on ne s’y trompe pas. Il ne s’agissait pas d’une amitié faite de convenances ou de devoir. Nous partagions le rêve — cette douce folie juvénile — de quitter la terre ferme pour plonger dans les eaux profondes de l’art, de la littérature et peut-être même de la célébrité.
Ce compagnon d’idéaux, admirait Arthur Miller comme d’autres vénéraient Galilée. Il rêvait d’écriture, comme moi je rêvais de peindre le monde avec mes couleurs intérieures. Et pourtant, comme dans toute trajectoire, nos orbites finirent par diverger. Lui, le sérieux, emprunta la voie droite de la librairie fondée à son nom, avec compagne bien née et respectabilité bourgeoise. Moi, l’aventurier, je choisis la tangente, le rêve américain, le précipice de la faillite.
Depuis lors, à chaque décision, chaque détour, j’interroge ce fantôme bienveillant : « Que penserait-il? » Non pour m’y conformer, mais parce que son regard, bien qu’absent, me suit comme celui de ces portraits anciens qui, accrochés à la proue de quelque navire de légende, semblent toujours vous fixer.
C’est peut-être cela, le véritable héritage de l’amitié : non l’échange quotidien, mais la permanence d’un regard, silencieux et intérieur, dont l’influence perdure comme la mémoire d’un capitaine dans les profondeurs du Nautilus.
Comme le disait Milan Kundera — et peu de vérités me hantent autant —, nous vivons sous des regards. Ceux d’inconnus, croisés dans le vacarme de la ville, dont le regard glisse sur nous comme l’eau sur une vitre. Ceux, plus rares, de ceux qui nous aiment et nous jugent avec tendresse. Et puis, il y a les regards absents. Ceux de ceux qui ne sont plus là, qui se sont éloignés, disparus, parfois morts. Mais leur jugement reste là, flottant dans notre conscience, comme un écho silencieux dans les couloirs de la mémoire. Ce sont eux, peut-être, les plus puissants.
Je pense souvent à mes parents. Ils m’ont élevé, appris la vie, puis ils sont partis. Je continue à sentir leur regard sur mes choix, comme s’ils étaient là, silencieux mais présents, dans chaque geste, chaque décision. Et je pense aussi à quelques amis, figures tutélaires de mon adolescence, ceux qu’on pourrait appeler des « petits pères », tant ils ont contribué à me construire. Il y avait, parmi eux, Jean-Noël Flammarion. Je l’ai rencontré au lycée Janson-de-Sailly, à l’aube de notre année de terminale B. L’année du bac — cette épreuve symbolique, rite de passage vers l’âge adulte — fut, pour notre génération, une période de trouble et de liberté mêlés.
Jean-Noël s’était retrouvé là comme moi, par un de ces coups du sort que les adultes appellent des « pistons » et que nous, jeunes, vivions comme des privilèges honteux. Lui était le fils d’une grande famille d’éditeurs ; quant à moi, on m’avait présenté au proviseur comme le fils d’un proche du ministre de l’Éducation. En vérité, c’était grâce à Mme Gélie, la secrétaire d’Edgar Faure, que j’avais intégré Janson. Elle connaissait mon père de loin, avait apprécié son élégance d’ancien diplomate et, en échange d’un bouquet et d’une caisse de Moët, elle avait décroché son téléphone. C’était une époque où un coup de fil valait de l’or.
Ce statut d’intrus nous rapprocha, Jean-Noël et moi. Chaque trimestre, nous étions convoqués chez le proviseur, sommé de raconter comment allaient « nos parents ». À cet âge, on ne mesure pas encore les frontières de classes. Nous nous sentions semblables, frères de fortune, complices dans l’art de critiquer les autres fils à papa aux voitures anglaises et aux vestes Renoma. Nous partagions nos enthousiasmes littéraires, comme une admiration féroce pour Belle du Seigneur, et nos médiocrités scolaires qui nous plaçaient à part.
Puis vinrent les découvertes. Le kif d’abord, goûté une nuit de réveillon sans en comprendre l’effet, puis partagé dans ma chambre de bonne à Neuilly. On y accédait par l’escalier de service, loin des regards familiaux. Là, dans cette soupente transformée en sanctuaire de liberté, je fis fumer Jean-Noël pour la première fois. Il me regardait peindre à la gouache, stone et fasciné, murmurant des rêves d’art, de reconnaissance, d’avenir. Il regrettait de ne pas être musicien, mais espérait écrire. Il admirait Arthur Miller, rêvait de suivre les pas de ceux qui avaient osé tout lâcher pour vivre leur vérité. Pourtant, déjà, je percevais en lui autre chose : une frustration sourde, un désir de puissance, une soif de reconnaissance.
Je fus celui qui l’entraîna dans la débauche. Le cannabis devint LSD, puis errances psychédéliques entre les néons des Champs-Élysées. Lors d’un trip, je me souviens de sa silhouette timide, traversant un café bondé, brandissant un billet de dix francs comme un talisman. Il était plus timide, plus retenu. Moi, j’avais branché deux Italiennes en vacances, logées par des sœurs sur l’Île Saint-Louis. La sienne, moins jolie, le faisait tourner en bourrique — jusqu’à ce qu’il la rejette avec une froideur que je jugeai mesquine, un jour où elle se montra enfin conciliante dans sa luxueuse maison de Saint-Cloud.
Mais Jean-Noël restait mon ami. Le seul qui gardait une voix de raison au cœur de mes dérives. Mon père m’avait offert une petite MG brune après le bac, et ce fut avec elle que nous partîmes pour la Suède. Il voulait découvrir le Nord, moi j’avais en tête les filles blondes et libres. Nous étions jeunes, et je croyais encore qu’un volant et un plein suffisaient à changer de vie. La route du retour, sur les autoroutes allemandes, fut éprouvante. Je conduisais, seul éveillé, veillant sur le sommeil de mon ami. Je me sentais responsable, presque paternel.
Des années plus tard, nos chemins se croisèrent encore. Il avait monté une librairie, épousé une fille de son monde, une femme dure, méprisante, qui ne m’aimait pas. Lui, pourtant, ne m’avait jamais tourné le dos. Il m’avait offert du travail quand j’étais dans le besoin. J’avais tenté de monter une filiale de son commerce aux États-Unis, une aventure vouée à l’échec. À mon retour, ruiné, changé, quelque chose s’était brisé. Quand je lui rappelai cette nuit de route où j’avais veillé sur lui, il répondit : « Peut-être, mais moi, j’avais plus d’argent. »
C’est alors que j’ai compris. Le lien entre nous n’était plus de ceux qu’on peut maintenir sans effort. La dernière fois que je l’ai vu, c’était un soir pluvieux. Il venait de tromper sa femme, était désespéré. Nous avons bu, je lui avais présenté deux Autrichiennes splendides. Mais quand il comprit qu’elles étaient au pair chez sa tante, il paniqua. Nous nous sommes séparés dans un silence chargé de malentendus et de fatigue. Après mes années américaines, il ne reconnaissait plus en moi celui qu’il avait connu.
Et pourtant. Chaque fois que je me suis retrouvé à un carrefour de ma vie, je pensais à lui. À ce qu’il aurait dit. À ce qu’il aurait jugé. Son regard, bien qu’absent, continuait de peser sur moi. Kundera avait raison. Le regard des absents nous hante davantage que celui des vivants.
Car nos vies ne sont pas seulement faites de ce que nous faisons, mais de ce que nous avons laissé derrière nous — les rêves inaboutis, les amitiés dévoyées, les illusions qui ne meurent jamais tout à fait.
Jean-Noël venait d’un monde. Moi, d’un autre. Il était né dans une famille d’intellectuels, petit-fils d’un vulgarisateur scientifique et fondateur d’une maison d’édition. Mon grand-père, lui, roulait des barriques de vin entre le Gers et le Tarn. Ma famille, une lignée paysanne, cultivait la terre et les mots en secret. Le nom même, Touge, désigne un buisson de la garrigue, têtu et enraciné.
Mon père, René Jean Touge, avait quitté le Sud-Ouest grâce à une bourse. Il devint instituteur, étudia le tchèque, devint officier de renseignement pendant la guerre, diplomate à Lisbonne, puis industriel. Il avait racheté le brevet des machines à tricoter Knittax et monté une usine dans Paris. Mais l’arrivée des pulls italiens bon marché ruina ses efforts. Il n’était pas préparé au cynisme des affaires. Sa conception de l’honneur m’avait façonné.
Et Jean-Noël, un jour, m’avait résumé d’un trait tout ce qui nous séparait : « Une bonne affaire, ce n’est pas quand tout le monde est content. C’est quand il y en a un qui pleure, et l’autre qui se frotte les mains. » Alors j’ai compris : nous n’étions pas du même monde. Nous avions seulement partagé une