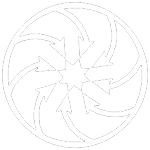Il semble, qu’une énigmatique conspiration numérique, en l’occurrence celle du chiffre douze, ne cesse de jalonner mon existence d’événements singuliers. J’étais revenu des vastes contrées américaines depuis quelque temps déjà, et c’est lors d’une matinée pluvieuse du mois d’avril que je me rendis, armé de quelques économies et d’un espoir aussi prudent que tenace, à l’hôtel de la Marquise de Brinvilliers situé 12, rue Charles Vdans ce Marais parisien où le passé semble suspendu à chaque pierre.
Là, dans un studio à hauts plafonds, anciennement affecté à l’intendance ecclésiastique et aujourd’hui mis à la location par un intermédiaire au regard sceptique, je fis la rencontre de plusieurs aspirants locataires, parmi lesquels figurait un couple de comptables aux traits orientaux, courtois et discrets. Devant l’évidence de leur stabilité financière et mon absence de feuille de paie — sésame tant prisé dans la capitale — je crus bon d’annoncer à l’agente de location mon infortune. Mais celle-ci, avec un sourire en coin, me fit remarquer que les propriétaires ne souhaitaient guère « des gens comme ça ». Je compris, non sans un léger frisson, que le préjugé s’était penché en ma faveur. Ainsi, avec ma physionomie avenante, quelques documents aux origines. douteuses, et l’aide involontaire d’une discrimination latente, je fus désigné comme le prochain occupant de ce lieu singulier. Ce lieu, tenez-vous bien, appartenait en réalité au Saint-Siège, et plus précisément aux Pères Oblats, qui y entretenaient une chapelle sous les combles.
C’est là que je fis la connaissance de Jean-Luc Moulène, personnage singulier s’il en fut, lequel résidait dans les étages supérieurs, près des toits où les vents de l’histoire semblaient souffler avec insistance. Artiste de son état, Moulène me révéla que l’ensemble des locataires de l’immeuble étaient, à l’exception des prêtres, des créateurs : peintres, poètes, plasticiens. De la cour intérieure s’élevaient, certaines fins d’après-midi, des voix étranges : celles de guides conduisant des groupes de visiteurs à travers l’histoire sulfureuse du lieu, relatant les sombres heures de l’affaire des poisons, et s’extasiant devant l’escalier monumental, chef-d’œuvre de l’architecture de Louis XIV.
C’est au sein de cette atmosphère féconde que je rencontrai Christine, future compagne de mes jours, lors d’une lecture poétique à la librairie américaine Village Voice, sise rue Princesse, dans le noble quartier de Saint-Germain-des-Prés. Nous étions alors au commencement d’un temps nouveau : François Mitterrand venait tout juste d’être élu à la présidence de la République, événement longtemps espéré par une partie du peuple, et j’avais quant à moi réussi à m’introduire à La Une, première chaîne de télévision française, grâce aux bons offices de Freddy Hauser.
Jean-Luc Moulène, en cette époque, s’adonnait à une forme de pratique artistique qu’il nommait avec audace l’apparitionisme. Il s’agissait, pour le dire simplement, d’infiltrer l’espace médiatique avec des images signifiantes, souvent provocatrices, toujours poétiques. Ainsi créa-t-il un visuel audacieux : une découpe de la Vierge dans La Croix, évoquant sa disparition le jour même de son apparition supposée. Je l’accompagnai à la rédaction du journal Libération pour une action symbolique : une horloge stoppée à minuit, au terme d’une grève historique. Une autre fois, c’est une cuillère percée Jean-Luc fit publier dans Le Monde, pour illustrer une journée contre la faim.
À Noël, l’idée fut d’offrir un véritable cadeau aux téléspectateurs. Dans le capharnaüm créatif des studios de Cognacq-Jay, je filmai Moulène sur le plateau déserté de l’émission 7/7. Il y décrivit son œuvre depuis l’intérieur d’une immense camera obscura, et, dans un geste à la fois spectaculaire et énigmatique, il fit éclater la lumière d’un flash logé dans sa bouche. Il annonça alors que l’événement promis aurait lieu à l’écran : les téléspectateurs, témoins de l’apparition, étaient invités à photographier l’image et à se rendre à la galerie Donguy, où Moulène leur apposerait sa signature, conférant ainsi à chaque cliché le statut d’œuvre d’art.
Ce fut un moment sans précédent : le journal télévisé du soir, suivi par plus de vingt millions de spectateurs, diffusa pendant cinq secondes un visuel énigmatique — un cyclope à l’œil unique, fruit d’un jeu optique avec la chambre noire. Ce que l’on y voyait, ou plutôt devinait, échappait aux codes du langage télévisuel : un time-code et un signal sonore de mille hertz s’y superposaient, signes techniques que seule la régie finale avait pu incruster en direct.
Ce fut une opération savamment orchestrée, que je coordonnai aux côtés de Freddy Hauser, le même qui m’avait introduit à La Une. Les clichés rapportés à la galerie furent nombreux, tous différents, souvent flous, toujours personnels. Moulène, alors inconnu du grand public, avait déjà compris que sa signature, fût-elle griffonnée sur une image imparfaite, suffisait à sacraliser l’objet. L’art contemporain, à ses yeux, était moins affaire d’objets que d’identités.
Et c’est ainsi qu’en cette fin d’année mémorable, une œuvre d’art télévisuelle naquit, unique, éphémère, immortalisée par une seule copie sans time-code, précieusement conservée dans les archives de l’INA. Une apparition, en somme, digne des mystères de l’époque.