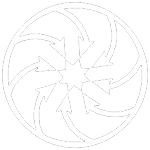« Le rêve est une seconde vie. Je n’ai pu percer sans frémir ces portes d’ivoires ou de corne qui nous séparent du monde invisible. Les premiers instants du sommeil sont l’image de la mort ; un engourdissement nébuleux saisit notre pensée, et nous ne pouvons déterminer l’instant précis où le moi, sous une autre forme, continue l’œuvre de l’existence. » Clément Ross
Vaut-il mieux rêver sa vie ou vivre ses rêves ?
La question semble d’abord inviter à une forme d’héroïsme intime, une exhortation à l’action : ne pas se contenter de rêver sa vie comme on rêve la mer devant un bureau, mais oser la vivre, la saisir à pleines mains, quitte à se brûler les ailes. Pourtant, cette opposition apparente masque un paradoxe plus profond, presque vertigineux, que Clément Rosset, philosophe du réel sans fard, ne cesse d’explorer : et si le rêve, loin d’être un élan vers la vie, n’était qu’un écran de fumée ? Une manière subtile — et tragiquement humaine — de fuir ce qui est.
À en croire Rosset, la tentation du double est universelle. Chaque homme, au fond de lui, nourrit le fantasme d’une réalité parallèle, d’un monde corrigé, embelli, transfiguré par l’imaginaire. Ce monde rêvé n’a pas besoin d’exister pour séduire : il suffit qu’il promette autre chose que l’ennui, la douleur, l’injustice du réel brut. Le rêve devient alors un refuge, un simulacre qui permet de supporter l’insupportable — ou plutôt, de détourner le regard. Le rêve est anesthésiant : il protège, certes, mais il endort.
Rêver sa vie, dans cette perspective, revient à se construire un décor de théâtre où l’on joue le rôle flatteur de celui que l’on voudrait être, dans une vie que l’on ne vit pas vraiment. C’est vivre en spectateur de soi-même, dans un récit intérieur cousu de « si seulement » et de « un jour peut-être ». Mais vivre ses rêves, au sens propre, suppose au contraire de confronter ses désirs à la matière rugueuse du réel, de descendre de la scène pour entrer dans l’arène. Or, c’est là que réside la difficulté : la réalité est sans pitié. Elle ne fait pas de place aux illusions, elle les fracasse. Ce monde, dit Rosset, « se moque de ce que les hommes sont comme de ce qu’ils y font. » On n’y est pas attendu.
Faut-il dès lors renoncer au rêve ? Pas nécessairement. Mais il faut sans doute apprendre à rêver autrement. Non pas rêver pour fuir, mais rêver pour éclairer ce qui est. Non pas substituer au monde un double idéalisé, mais habiter ce monde-ci avec assez de lucidité pour en tirer la beauté tremblante, souvent dérisoire, parfois bouleversante. La vie réelle, dans sa nudité, n’est ni un rêve ni un cauchemar : elle est ce qu’elle est, dissonante, imprévisible, fragile. Vivre ses rêves n’a donc de sens que si l’on consent d’abord à regarder en face la matière du réel — même lorsqu’elle déplaît.
Rosset nous met en garde, non contre le rêve lui-même, mais contre son détournement : contre le mensonge de l’idéal qui devient tyrannie, contre l’illusion d’un ailleurs qui condamne le présent. À trop rêver sa vie, on risque de ne plus la vivre du tout. À vouloir fuir ce qui est, on perd le goût du monde tel qu’il s’offre, et l’on s’aveugle à sa poésie discrète.
Finalement, il ne s’agit peut-être pas de choisir entre rêver sa vie ou vivre ses rêves, mais d’apprendre à faire coïncider les deux. À rêver dans sa vie, et non à la place de sa vie. Car le plus grand rêve est parfois celui qui accepte de s’incarner, maladroitement, dans le réel imparfait. Celui qui ne cherche pas un double du monde, mais s’invite dans sa vérité même.