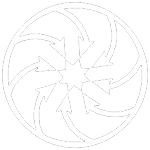J’avais rencontré Isabee une française en vacances que Georges avait dragué je ne sais où. Elle voyageait avec une canadienne Eva et son gros chien vaguement husky noir et blanc. Les amenaient à Santa-Cruz pour leur faire rencontrer les surfeurs de la Harbour House. L’allure de top model d’Eva et la classe bcbg d’Isabelle les ont impressionnés. Elles voulaient aller plus au sud et je leur proposait de faire un coup de traveller checks et de partir au mexique. C’est à dire déclarer les travellers perdus pour se les faire rembourser et pour ma part je louerai une voiture pour aller au Mexique. A cette époque il n’y avait ni ordinateur ni carte de crédit et on pouvait louer une voiture avec une caution de cinquante dollars et un passeport et pas besoin de la rendre. Je l’avais déjà fait deux fois à Los Angeles ou j’avais passé le premier mois de mon arrivé aux USA. C’est une de ces voitures une Javelin jaune que j’avais conduit jusqu’à Santa Cruz pour rendre visite à Mike et Johnny que j’avais rencontré l’été dernier à Biarritz. Ils étaient descendu en mobylette et sur le chemin du retour fin aout je les avaient hébergés chez mes parents en vacances.
La Dodge Charger que j’avais loué me donnait un sensation de puissance avec son moteur V8 de cinq litres. A l’intérieur pourtant il n’y avait pas tant de place avec les sacs à dos des filles et le chien. A los Angeles avant de partir j’avais convaicu Isabelle de faire un coup de traveller checks. C’était un truc que m’avais appris Jean-Marc Landau qui avait été à Hawaï et m’avais mis ces idées de pirate des temps modernes en tête alors que j’étais encore étudiant. Cela consistait à les déclarer volés et se faire rembourser puis les utiliser en pays lointain. J’avais une fois dans une banque en Belgique passé des travellers déclarés volés la peur au ventre car je n’avais rien d’un criminel dans mais je trouvait cela romanesque. Parti en fin d’après-midi de L.A avec la Dodge nous roulons toute la nuit pour nous retrouver au petit matin sur un terrain vague arride et désert au milieu de nulle part. ll y avait un espèce de motel avec des cabine en bois et je pu me reposer nu sur un ban de bois avec la chaleur qui montait dès le matin. A peine deux heures plus tard les filles entraient dans ma cahute pour me dire que je n’étais pas sexy et qu’il fallait qu’on roule. Finalement nous arrivons à Mazatlan le soir du deuxième jour du voyage.
Mazatlan était déjà un de haut lieu du tourisme et la plage s’étendait sur des kilomètres le long d’un muret en ciment. La nuit était tombé et nous nous baignons avec ravissement dans l’eau chaude de l’ocean pacifique. Un petit mexicain nous aborde pour nous vendre un bouteille de mescal avec son gros ver au fond qui est d’après lui la vraie boisson du cru . Déjà bien éméchée Isabelle se pâme allongée dans lqualques centimètres d’eau du bord de plage en disant « on dit que c’est le paradis ici ». Nous rejoignons des jeunes jeunes gens américains qui font un feu de camp et l’alcool aidant je finit par baiser sur la plage une étudiante californienne dont je ne connais pas le nom avant de m’endormir sur la plage. A matin la plage s’anime avec des surfeurs alors que les locaux restent sur le muret à l’affût d’un opportunité. Un des américain à l’allure de fraternity boy me demande s’il peut emprunter ma voiture pour aller chercher sa planche de surf à l’aéroport. Il y a tout pour vivre sur la plage avec les vendeurs de tacos ambulants st j’oubli le temps jusqu’au moment ou j’ai besoin de quelque chose dans la voiture. La voiture à disparu et le crétin qui est revenu avec sa planche me dis qu’il a mis les clés derrière la calandre. Il y avait tout dans la voiture. Les sacs des filles, nos papiers et les fameux traveller checks que j’avais mis sou le tapis de sol. Au moins ils auront été vraiment volés. Je b’ai plus sur moi qu’un short Hang Ten rouge et une paire de sandales typiques du Mexique achetés plus tôt sur le chemin. La fille de l’autre nuit s’appelle Tricia et me donne un pantalon beige en velours qui me va et le surfeur crétin un T-shirt. Les filles se sont renseignés et parlent d’un train qui pourra les ramener en Californie en trois jour. En ce temps là les services d’immigration n’étaient pas sur les dents et elle trouveraient bien un moyen de passer la frontière même sans papiers. Tricia me dit d’aller voir sa soeur qui fait des études dans une université bilingue près de Mexico City. Je décide de pousser l’aventure et d’y aller pour demander un passeport au consulat. Pour cela je dois faire plus de mille kilomètres sans le sou dans un pays que je ne connais pas. Je serai le Hobo du Mexique.
Je n’avais pour tout bagage que ma bonne tête et mes sandales mexicaines, de robustes zapatos dont la semelle, taillée dans un vieux pneu d’automobile, témoignait d’une ingénieuse économie digne des peuples les plus pauvres. Ainsi équipé, je m’élançai sur la route poussiéreuse de l’État de Sinaloa, le pouce levé vers l’horizon, en direction de la capitale de ce vaste pays.
À cette époque, le Mexique voyait affluer quantité de touristes américains, hardis voyageurs juchés sur des pick-up surchargés ou entassés dans de bruyants minibus Volkswagen. De halte en halte, porté par cette migration mécanique, je progressai rapidement jusqu’aux environs de Guadalajara. Là se trouvait un terrain de camping où une brave famille, touchée par mon récit et m’ayant nourri avec une générosité toute fraternelle, décida de me laisser. Avant de partir, elle me remit une vieille couverture mexicaine, blanche écrue à fines rayures, qui devait longtemps encore me servir de manteau nocturne.
Je fus alors saisi d’un émerveillement profond devant la nature qui m’entourait. Je l’explorai avec l’ardeur d’un naturaliste en terre vierge, jusqu’à parvenir au bord d’un grand lac paisible, miroir d’azur serti de verdure. Sur sa rive se dressait une magnifique demeure. À peine m’en étais-je approché qu’un homme d’âge mûr, à l’allure distinguée, m’interpella. C’était le propriétaire. Tandis que je m’efforçais de lui adresser la parole dans un espagnol hésitant, il devina à mon accent que j’étais français — et me révéla aussitôt l’être lui-même. Propriétaire de la Fábrica de Francia et consul honoraire à Guadalajara, il m’écouta avec bienveillance. Hélas, il ne pouvait rien pour mes papiers : pour cela, il me faudrait gagner Mexico. Mais convaincu de ma sincérité, il me remit un billet de cinquante pesos.
Cette somme représentait une véritable fortune : de quoi subsister plusieurs jours à coups de tacos fumants. Je repris donc la route. Un petit homme barbu, maigre comme un roseau, me fit grimper dans son minibus VW à toit ouvrant. Je me tins debout, la tête au vent, contemplant le défilement somptueux des paysages de verdure tropicale. Entre deux occasions, je dormais dans les fossés, parfois sous l’abri sommaire d’un petit pont. Au matin, mon visage se trouvait gonflé par les piqûres d’insectes redoutables, mais le soleil et ma robuste constitution faisaient promptement disparaître ces stigmates.
Nous montions déjà vers les hauts plateaux du Mexique, et trois jours après mon départ de Mazatlán, j’atteignis l’immense Mexico D.F., fourmillante comme une ruche humaine. On me déposa dans le quartier le plus touristique, là où les mariachis, instruments à la main, attiraient les badauds. Les tacos coûtaient un peso cinquante, et je me liai rapidement d’amitié avec les chavos de la rue. Lorsque la nuit tomba et que les touristes se furent dissipés, je m’apprêtais à dormir sur le trottoir quand l’un des gamins m’invita à le suivre dans ce qui semblait n’être qu’un trou béant dans un mur. C’était un dortoir de miséreux : pour trois pesos, on obtenait une paillasse douteuse sur un lit superposé. Bien que je n’eusse rien à craindre du vol, cet abri me parut infiniment plus sûr que la rue.
Le lendemain, je me rendis au consulat français afin d’y entamer mes démarches administratives. On m’avertit que la confirmation de Paris prendrait du temps. Il me restait toutefois assez d’argent pour prendre un bus vers Cholula, à l’adresse que m’avait donnée Tricia.
L’été mexicain avait commencé. Sous une pluie battante, le car de la Flecha de Oro dévala à une vitesse alarmante les routes sinueuses menant à Puebla. Un bus local me conduisit ensuite jusqu’à Cholula. Trempé, je cherchais le numéro huit de la rue Poniente — ici, les rues portent les noms des points cardinaux. La maison était belle, moderne, et la jeune femme qui m’ouvrit la porte avait l’allure d’une apparition. Brune, aux formes généreuses, elle se nommait Teresa. Elle m’accueillit avec un sourire lumineux et m’invita aussitôt à entrer.